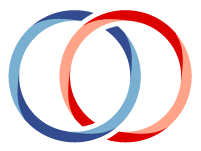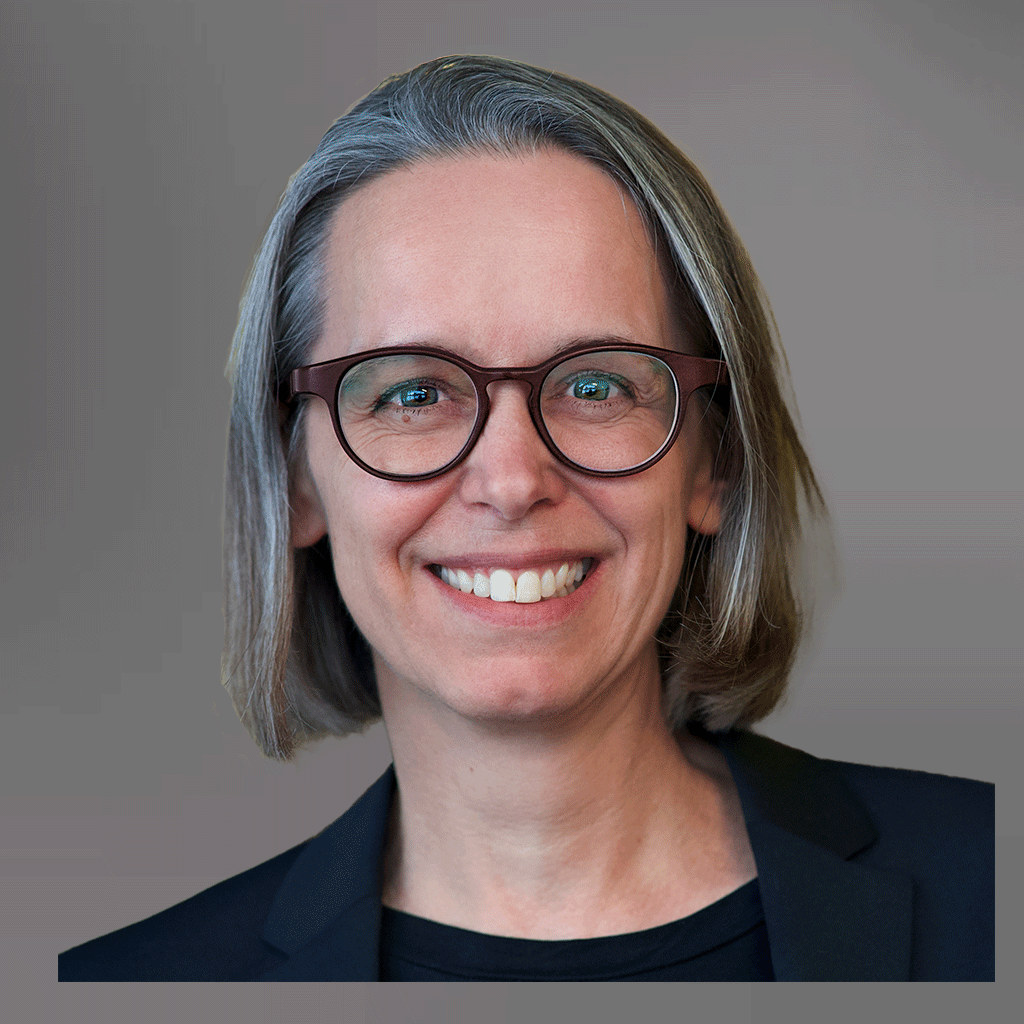François Legault se dit fier de la construction lourdement subventionnée d’une usine de batteries en lithium-ion pour les véhicules électriques par la firme suédoise Northvolt. À rebours des critiques qui dénoncent la destruction des espaces protégés, le premier ministre met l’accent sur le développement d’une « économie verte » en sol québécois. Il n’est pas nouveau que l’État cherche à faciliter les conditions et attirer les investissements par le déploiement de politiques industrielles. Ce qui est nouveau, c’est d’en parler en termes de politiques industrielles vertes.
Des politiques industrielles vertes
Dans le passé, les économistes avaient plutôt décrié les politiques industrielles : elles ne sauraient pas miser sur les créneaux et les technologies performantes et freineraient l’innovation et la concurrence. Ces dernières années, on a cependant vu réémerger ces politiques – et singulièrement les politiques industrielles vertes – aux quatre coins du monde. En combinant des investissements publics, des incitatifs et des réglementations, l’État encourage le développement de technologies et la croissance d’industries qui permettent d’accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
La Chine en est le précurseur. Certes, elle est la plus grande émettrice de gaz à effet de serre (GES). Sa stratégie développementaliste, débutant dans les années 1990, a toutefois transformé en profondeur le marché mondial des énergies renouvelables et maintenant des voitures électriques.
De son côté, l’Union européenne a adopté dans son plan de relance post-Covid des objectifs ambitieux de transition énergétique; son Pacte vert (Green New Deal) est fortement tributaire des investissements publics. Ce sont toutefois les États-Unis avec leur Inflation Reduction Act et d’autres pièces législatives adoptées sous l’administration Biden qui ont rendu incontournables les politiques industrielles vertes. Malgré les opinions divergentes sur le changement climatique, ces politiques encouragent l’investissement dans la production d’énergie nationale et la promotion d’énergie propre.
Dans L’État face à la crise environnementale, je montre que l’intervention de l’État en matière environnementale n’est ni aussi récente ni aussi modeste qu’on pourrait le croire. Depuis plus de 50 ans, au Québec comme dans la plupart des économies avancées, l’État prévient les effets nocifs des activités humaines sur la santé et l’environnement en recourant à des interdictions et à des obligations, mais aussi à des incitations et à des mécanismes de marché comme les taxes ou les marchés du carbone. Au fil du temps, et un peu à l’image de l’État-providence en matière sociale, on a mis en place un appareil administratif et législatif, un « État environnemental » qui peut atténuer les impacts environnementaux du développement économique.
Mais l’État environnemental n’est pas qu’un acteur : il est aussi un espace de coopération et de conflit politique. Ce sont ces rapports qui définissent la marge de manœuvre dont les gouvernements disposent pour agir et réagir en matière environnementale et climatique. Si l’État environnemental a développé son action de manière aussi importante, c’est surtout en réponse aux revendications socioéconomiques et écologiques.
Comme on le voit de Bruxelles à Edmonton, la politique limite à son tour la marge de manœuvre de l’État environnemental. Le bien-être et la prospérité que nous prenons pour acquis reposent sur un mode de vie qui laisse une empreinte lourde sur le plan environnemental, notamment par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et la destruction des ressources naturelles et de la biodiversité. Pour un gouvernement qui souhaite se maintenir au pouvoir, il est risqué de mettre en question ce mode de vie basé sur la surconsommation.
Depuis plus de 50 ans, au Québec comme dans la plupart des économies avancées, l’État prévient les effets nocifs des activités humaines sur la santé et l’environnement en recourant à des interdictions et à des obligations, mais aussi à des incitations et à des mécanismes de marché comme les taxes ou les marchés du carbone.
Emplois et croissance économique
D’une certaine manière, les politiques industrielles vertes que l’on promeut aujourd’hui se veulent une réponse à l’impasse politique des interventions précédentes menées par l’État en matière environnementale. Ainsi, le président Emmanuel Macron s’est vu confronté aux gilets jaunes qui rejetaient, parfois avec violence, l’augmentation du prix des carburants automobiles. Le prix des carburants et la réglementation sur la diminution de l’usage des pesticides ont mis en colère les agriculteurs des Pays-Bas jusqu’en Espagne, alors que les propriétaires allemands s’opposent à l’obligation d’installer des thermopompes dans leurs maisons individuelles. Au Canada, le gouvernement fédéral subit actuellement son propre ressac politique pour avoir voulu imposer un prix sur le carbone.
Dans ce contexte, les politiques industrielles vertes apparaissent comme une stratégie opportune. Certes, elles coûtent de l’argent public, mais elles promettent aussi des emplois et de la croissance économique. Après des années de blocage, l’administration américaine de Joe Biden a réussi à faire adopter des lois climatiques ambitieuses malgré la polarisation extrême du Congrès. En investissant dans les régions qui dépendent historiquement de l’extraction du charbon, comme c’est le cas aux États-Unis et en Europe, un plan vert permet d’élargir les coalitions politiques susceptibles de soutenir l’action environnementale de l’État. Des juridictions aussi diverses que la Californie ou l’Inde se dotent aujourd’hui de politiques industrielles vertes qui cherchent à conjuguer développement économique et transition énergétique.
La mobilisation actuelle contre le projet de Northvolt au Québec illustre toutefois que les politiques industrielles vertes ne sont pas la panacée. Elles requièrent une capacité administrative et une expertise étatique pour conduire un examen approfondi et judicieux des gains et des pertes sur le plan environnemental, social et économique.
Par exemple, le lithium-ion sera-t-il la technologie pour les batteries de voitures électriques qui s’imposera sur les marchés à l’avenir? Si oui, comment le Québec pourra-t-il se positionner avantageusement dans cette filière et s’assurer du maintien des emplois à moyen et à long terme? Les retombées économiques et le bilan environnemental – GES évités contre biodiversité détruite – justifieront-ils les subventions publiques? Ces calculs ne se font pas sur le coin d’une table. Sans un examen sérieux, on risque de déplacer les problèmes environnementaux sans avoir la garantie d’un gain économique.
L’action environnementale de l’État, qu’elle prenne la forme de politique industrielle, de réglementation, de taxe ou d’arbitrage des règles du jeu des marchés du carbone, n’est pas une garantie que nous gagnerons la course contre le tic-tac de l’horloge climatique. Mais l’État semble être la seule institution capable de coordonner les actions des êtres humains et d’accélérer les processus de transformation de nos sociétés nécessaire pour répondre aux crises environnementales comme l’urgence climatique.